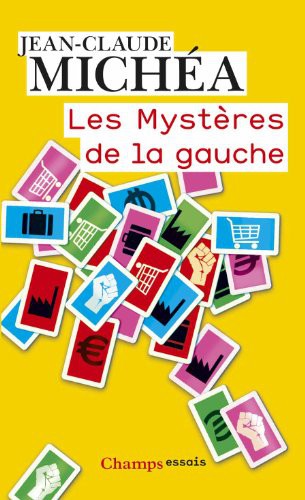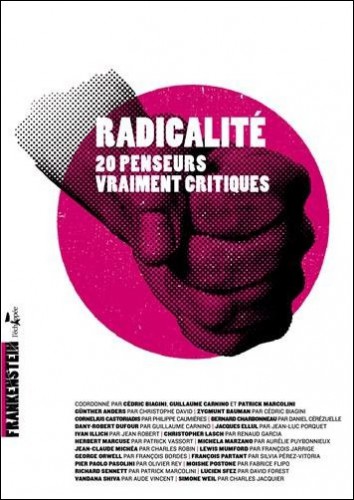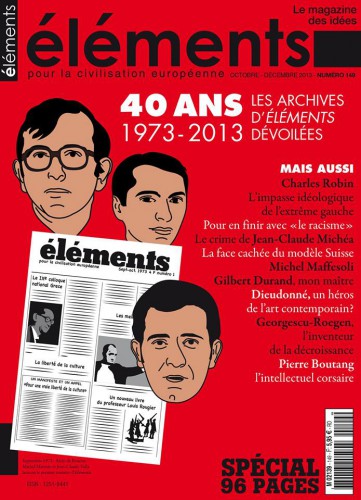Nous reproduisons ci-dessous un entretien avec Eric Zemmour, publié dans le Figaro et consacré à la guerre menée par la gauche oligarchique contre le peuple français...

Zemmour : « La gauche Terra Nova a déclaré la guerre au peuple »
Depuis la dernière conférence de presse de François Hollande, la plupart des éditorialistes de droite comme de gauche applaudissent le tournant social-libéral du président de la République. Mais François Hollande n'a-t-il pas toujours été social-libéral?
Pour moi, il n'y a pas de tournant. À partir du moment où François Hollande avait ratifié le traité budgétaire signé par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, et où ni l'Euro ni le libre-échange n'étaient remis en cause, il n'y avait pas d'autre politique possible. François Hollande, héritier de Jacques Delors le savait depuis le début de son mandat, sans doute même depuis la campagne électorale. Pour prendre une image automobile, le président de la République est sur l'autoroute de cette politique là et auparavant il n'a fait qu'acquitter des péages à la gauche qui l'avait porté au pouvoir: la taxe à 75%, les mots sur la finance qui serait son «ennemi»…
Certains vont même jusqu'à parler de Bad Godesberg français... De quand date réellement la conversion de la gauche française au libéralisme?
Le virage le plus récent et le plus marquant est celui de 1983, lorsque François Mitterrand arrime la monnaie française au Deutsche Mark et se jette dans le libre-échange. À partir de ce moment-là, la messe est dite et la gauche s'éloigne des classes populaires. Un lent abandon qui est théorisé par la note de Terra Nova avant la présidentielle de 2012 qui recommandait au PS de «remplacer» le peuple par les immigrés et à la marge par les cadres et les femmes diplômées. Comme l'a fait, avec brio, le philosophe Jean-Claude Michéa, il faut remonter beaucoup plus loin. Le tout premier tournant date de la fin du XIXe siècle avec l'affaire Dreyfus. Au nom de la défense des droits de l'homme, les socialistes se sont alors ralliés à la gauche libérale renonçant à leur spécificité: la volonté de contraindre l'individu au nom de l'intérêt supérieur de la collectivité. À partir de ce renoncement, le socialisme se condamnait à être ce qu'il est devenu.
Une phrase magnifique prononcée par une vieille dame riche dans La IIIe République de Jacques Bainville résume ce nouvel état d'esprit: «Sous la République, l'argent prenait son bien en patience». Cette formule splendide qui date de 1900 aurait pu être prononcée dans les années 80 sous Mitterrand. À partir de mai 68, on constate l'émergence de la gauche libertaire avec le slogan: «il est interdit d'interdire». Avec le libertarisme, cette gauche charrie déjà le libéralisme sans le savoir. Elle va peu à peu dominer la vieille gauche étatiste et socialo-communiste. En quelque sorte, Daniel Cohn-Bendit règle son compte à Georges Marchais!
Dans ce contexte, qu'est-ce qui distingue encore la gauche de la droite?
Depuis 30 ans, la gauche a abandonné le peuple et la droite la nation. La gauche avait abandonné la nation dès la fin du XIXe siècle et encore plus en mai 68. Par l'intermédiaire du général de Gaulle la droite l'avait récupérée. Après sa mort, elle l'a de nouveau délaissée par vagues européistes successives. De ce constat découle qu'il n'y a plus grande différence entre une gauche social libérale et une droite libérale social. Reste à la marge des gens qui se distinguent. Le discours sur les frontières de Nicolas Sarkozy durant la campagne de 2012 se démarquait clairement du discours dominant… Mais il se démarquait aussi de la politique de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans. Et il n'est repris par personne aujourd'hui.
La feuille de route du gouvernement sur l'intégration a suscité un tollé. Les vraies différences se situent-elles désormais sur les questions identitaires et sociétales?
Le prix à payer pour la soumission définitive de la gauche au libéralisme économique, c'est effectivement la marche en avant totalitaire vers un libéralisme sociétal. Comme on peut le voir à travers la politique de Najat Vallaud-Belkacem, qui reprend aujourd'hui les programmes que l'inter LGBT promeut depuis 15 ans, ou à travers le rapport sur l'intégration qui prône le retour du voile à l'école, la gauche brûle aujourd'hui ses vaisseaux sociétaux. Elle le fait pour deux raisons assez simples.
Premièrement, comme on l'a déjà dit, pour masquer sa conversion au libéralisme mondialisé.
Deuxièmement, parce qu'elle sent qu'il y a «un retour de bâton» dans le pays réel comme le montre les sondages. Tous l'électorat de droite, de l'UMP au FN, fait désormais bloc sur les thématiques sociétales, immigrationnistes et sécuritaires, mais désormais la moitié de l'électorat de gauche les rejoint également. Il y a une donc une volonté idéologique de la part de la gauche de briser ce qui leur apparaît comme le comble du fascisme: le peuple français. Celui-ci est à leurs yeux, racistes, xénophobe et homophobe. Et les lobbys pourtant ultra minoritaires, qui dictent leur loi au gouvernement, veulent profiter du quinquennat de François Hollande pour imposer leur vision de la société de manière irrémédiable. Il s'agit ni plus ni moins d'une déclaration de guerre.
Vous avez voté François Mitterrand en 1981. Face à l'effacement du clivage droite/gauche où vous situez-vous désormais?
J'ai rompu avec la gauche depuis 1984 et la naissance de SOS racisme qui avait justement marqué le début de la dérive sociétale des socialistes. Je me reconnais depuis toujours dans le vieux courant bonapartiste français à la fois national et social. Mais ce courant a été détruit par l'Europe et la mondialisation et n'a plus vraiment de leader depuis la défaite du non au traité de Maastricht en 1992. Philippe Séguin et Jean-Pierre Chevènement qui étaient les principaux représentant de ce mouvement à droite et à gauche ont échoué à lui donner des débouchés électoraux, même s'il reste paradoxalement majoritaire dans le pays réel.
Eric Zemmour (Le Figaro, 4 février 2014)